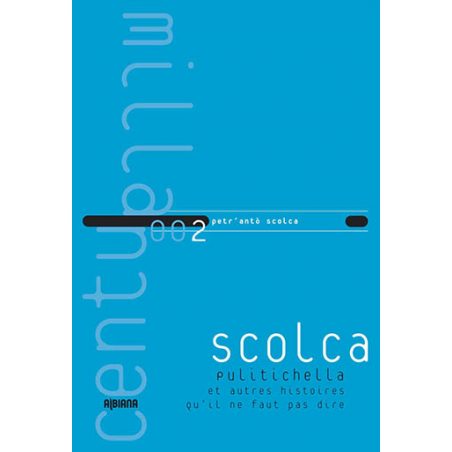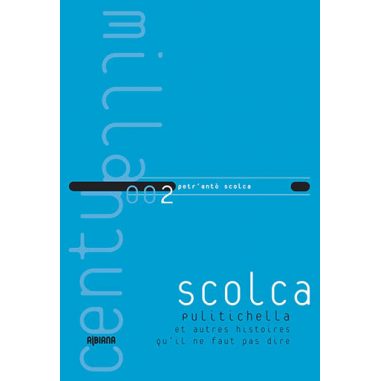Extrait
« Évidemment tout ce qui est raconté ici est complètement imaginaire et n’a rien à voir de quelque manière que ce soit avec des événements réels passés ou présents. Pour les besoins du récit, j’ai placé les histoires dans certaines villes et certains villages mais ce n’est qu’une licence d’auteur. »
« Il n’y a que des morts dans vos histoires ! Vous ne connaissez rien de plus gai ? »
Il tousse très fort et tente de boire une gorgée d’eau.
Depuis le début de la semaine, je monte ici chaque jour et lui me décrit avec ses mots précis une cartographie nouvelle de l’île. Je ne sais pas si j’aime entendre ce qu’il raconte mais j’aime l’entendre raconter. Posément, en cherchant l’expression juste, en donnant à sa phrase une période, une portée.
« Il n’y a rien de plus gai ici. Les gens sont sombres dans ce département. La facilité et les apparences, c’est pour la Corse du Sud. Nous, de ce côté des monts, nous avons apprivoisé depuis toujours le visage obscur de la fatalité et c’est cela qui nous réunit. Savoir que la haine est un liant plus fort et plus durable que l’amour, la haine partagée et dirigée contre les autres. Celui qui ne veut pas penser ou agir comme les autres, celui-là doit être abattu. Par tous les moyens. Ici, il n’y a pas de place pour les compromis. Tu es avec moi, tu es contre moi. Si tu es avec moi, tu ne peux pas apprécier le bonheur, la sérénité, l’innocence. Tu sais qu’il faut payer les choses. »
Par la fenêtre ouverte – il fait un peu plus chaud aujourd’hui et le ciel s’est relevé enfin –, je vois en face de nous, solitaire, solide encore, abandonné et toujours debout, l’ancien hôtel des curistes. Un lieu célèbre autrefois, quand les eaux d’Orezza attiraient vers elles les villégiateurs de l’Europe du Nord. Dans les étreintes vertes des châtaigniers, le bâtiment surnage à peine.
« Être du même sang, cela ne suffit pas ici, tu l’as bien vu dans cette histoire. Il faut être du même cœur, de la même pulsation cardiaque. Vivre avec les autres, complètement, et adopter tous leurs délires comme des règles de vie parfaites. Ne pas dépasser la tête de la file, ne pas regarder là où ils ne regardent pas, ne jamais penser. Juste respirer en même temps qu’eux le parfum étriqué des préjugés.
– Je prends ça comme une leçon de vie, alors ? » Je l’interroge brusquement et il lève sur moi ce regard qui a tout vu, ce regard qui vient du fond de l’abysse.
« Une leçon de vie, une leçon de mort. Cela a peu d’importance. Ce qui compte, tu vois petit, c’est le café. »
Le sanglier s’exécute pour nous.
- Interview de Petr’Antò Scolca à propos de Pulitichella et autres histoires qu’il ne faut pas dire
Albiana : Vous signez dans la toute nouvelle collection Centu milla, Pulitichella et autres histoires qu’il ne faut pas dire. Pourquoi diable ne faut-il pas les dire ?
Petr’Antò Scolca : Le silence fait partie des valeurs traditionnelles masculines, notamment en Méditerranée. S’ajoute en Corse un péché d’orgueil. Il ne suffit pas de se taire ; encore faut-il laisser entendre que des secrets formidables, susceptibles d’ébranler les cieux et les mondes, sont sévèrement celés. La valeur du mutisme devient alors exponentielle, et l’attitude digne du héros, le regard levé vers le ciel, un long soupir s’échappant de sa vaste poitrine, marque toute la dimension tragique du véritable sacrifice. Se taire, c’est pouvoir accéder au théâtre du silence.
A : Et pourquoi les dites-vous ?
Scolca : Je parle, ou plus exactement j’écris, et cela, c’est la limite minimale de la liberté individuelle. C’est pour moi une soupape obligée. Il me semble que l’île explose à cause du non-dit, de la rumeur, des inventions qui remplacent, bien avantageusement parfois, la révélation des tristes secrets de polichinelle. L’île vit sa schizoïdie quotidienne, entre l’envie naturelle de jouir des mots, le don propre aux Corses de la péroraison, de l’envolée lyrique, du délire verbal parfois, et puis cette chape de plomb qui anéantit toute convivialité. Dans les cafés, on ne peut rien dire. Ou plus exactement, on regrette ensuite ce que l’on a dit. Les oreilles ont des oreilles, ici. Il faut savoir que les points d’équilibre sont extrêmement fragiles dans une population totale de moins de trois cent mille habitants : chaque mot prononcé sur quelqu’un est entendu obligatoirement par un parent ou un ami. Quel malheur : nous avons ici les plus belles femmes du monde, et nous ne pouvons même pas leur rendre un hommage vibrant. Il y a dans le respect excessif une valeur préservative que l’on peut regretter.
A : Cette collection Centu milla suppose des textes courts, nouvelles, poèmes, récits brefs. Est-ce votre univers littéraire que l’art du court ou devez-vous vous astreindre à celui de la soustraction ?
Scolca : Quand Bernard Biancarelli m’a proposé le concept, je suis devenu fou de joie. 100 000 signes, c’est exactement ma vitesse de croisière, mon rythme idéal en matière littéraire. Au-delà, je peux, et j’ai déjà été, mais cela devient un autre exercice, nécessitant un véritable travail, et d’architecture, et de recherche, et de volonté.
A : Allons plus loin si vous le voulez bien. Qu’est ce qu’écrire et pourquoi écrire ?
Scolca : Écrire, c’est vivre libre. L’écriture est un jeu splendide, un jeu d’échec parfois, un solitaire toujours, mais c’est un véritable jeu de pouvoir. Arriver à se surprendre en alignant des mots, rater ses rendez-vous pour terminer un mouvement, s’arrêter de conduire pour chercher un stylo : l’écriture vous propose une relation extrême. Si vous plongez, vous êtes définitivement perdu au monde humain. Je ne sais pas par contre s’il y a une raison pour écrire. Je crois qu’on a envie d’accumuler des bouquins, de vider sa tête de toutes les histoires, et puis surtout d’écrire le plus de fois le mot fin, et de continuer à vivre ensuite.
A: J’extirpe quelques citations que prononcent vos personnages dans votre livre : « La Corse a le cancer, elle aussi. Elle crève, elle souffre, elle se décompose, rongée par ses propres instincts de vie. » « Il n’y a que des morts dans vos histoires. » « La haine est plus forte que l’amour. » Le tableau est plutôt sombre et il semble qu’actuellement, ce soit une constante de la scène littéraire corse. Qu’en dites-vous ?
Scolca : Ce n’est pas une constante actuelle, c’est le ton littéraire de l’île depuis toujours. J’ai participé à un recueil de nouvelles en faveur des handicapés, Piccule fictions, et j’ai été impressionné par l’univocité des textes. Nous sommes dans un pays de polyphonies, mais elles s’inscrivent quasiment toutes dans une tonalité sombre. Si l’on considère le rapport étroit de la Corse avec la mort, on comprend mieux cette prosopopée funèbre. Nous ne sommes peut-être pas Jansénistes, mais il y a dans la joie et l’humour quelque chose de vain, d’incommodant, de déplacé. Chaque Corse peut sourire, mais il sait que le tombeau l’attend, et qu’il devra rendre des comptes. C’est l’arrière-fond de toute œuvre, on peut le regretter sans doute. Et donc devenir encore plus sombres. Vous voyez, c’est comme la dépression, un phénomène d’accumulation à l’infini, et ça marche de mieux en mieux à chaque fois. Le malheur, un métier d’avenir !
A: Parce que si je vous cite vous, directement, sans le masque des personnages dont un auteur peut toujours dire que les opinions qu’ils émettent ne sont pas les siennes, voici ce que vous écrivez en guise de préambule ou d’avertissement : « Évidemment, tout ce qui est raconté ici est complètement imaginaire et n’a rien à voir de quelque manière que ce soit avec des événements réels ou passés ». Puis-je me permettre de vous dire que je n’en crois pas un mot ?
Scolca: Cela m’étonne grandement, car je n’ai pas du tout pour habitude d’inventer quoi que ce soit. Donc si je dis que ce n’est pas vrai, vous devez me croire.
A : En avez-vous d’autres en réserve de ces histoires à ne pas dire ?
Scolca : Bouh, des sacs. Pas obligatoirement des histoires à ne pas dire, mais des tas de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, de poésies — malheur, même des poésies. J’écris depuis 1974, et je ne suis publié que depuis 1996 : il y a donc beaucoup beaucoup de marge. Le problème avec tous ces textes, c’est qu’ils sont clos depuis trop de temps. Je me dis toujours que je vais les rouvrir, les mettre au goût du jour, etc. Et puis je me retrouve en train d’en écrire de nouveaux. Avec Pulitichella, c’est exactement ce qui s’est passé. J’ai voulu recopier au propre un vieux manuscrit, mais cela m’épuisait nerveusement. J’ai repris une bonne tasse de café, j’ai rangé le manuscrit, et j’ai tout reconstruit. Mes exécuteurs testamentaires ne vont pas se reposer, les pauvres.
A: Est-il possible que vous nous disiez si vous avez une grande dose d’instabilité affective ?
Scolca : Non, non, je fais tout de manière équitable : je pleure trois fois par jour, et je ris trois fois par jour, en suivant un planning très rationnel. Je m’octroie des pauses de quatre heures trente pour la sieste, je hurle à 115 décibels chaque premier mercredi du mois, et je me cantonne à quatre maîtresses seulement. Un écrivain parfaitement dans la moyenne.
A : Aurons-nous l’occasion de vous retrouvez dans Centu milla ou ailleurs ?
Scolca : À ce jour, j’ai trois Centu milla de prêts, toujours des nouvelles parce que je profite de la carte blanche d’Albiana. Donc si Albiana le veut bien, je reviendrai. Pour l’instant, vous pouvez me retrouver dans Palermu, avec Alain de Rocco, collection Nera. C’est un livre beaucoup plus drôle. Mon ami Jean-Pierre Santini qui n’est pas un critique facile le compare à un guignol’s band sicilien. Je trouve que la formule colle à merveille à ce roman.
A : Je m’aperçois avoir posé dix questions à vos collègues auteurs ayant inauguré cette collection. Vous n’en êtes qu’à neuf. Voulez-vous vous poser la dixième ?
Scolca: Petru, quand est-ce que tu vas écrire le grand roman corse ?