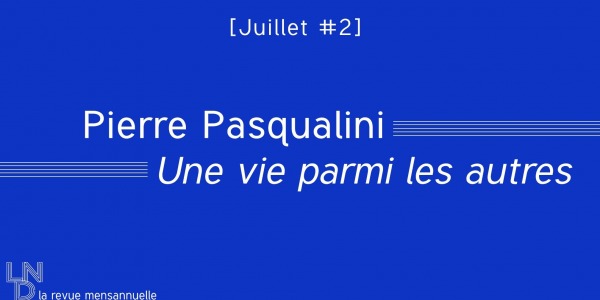- Decameron Libero
- 5 likes
- 12633 views

Le promeneur des temps figés, imaginé par Robert Colonna d’Istria, tire quelques leçons du confinement : la lucidité n’empêche pas le bonheur.
L’homme confiné
Des inconvénients du confinement et de ses avantages
Le confinement avait été pour lui plein de frustrations superficielles. De minuscules petits inconvénients, érigés au rang de désastres, qui coloraient ces jours sereins de teintes mélancoliques.
Cette année-là aurait donc été sans printemps. Du moins n’avait-il pas pu jouir du printemps au contact de la nature – ce à quoi, chaque année, il accordait du prix. Quand les jours rallongeaient, il aimait la naissance du printemps, l’attendait, la guettait, et s’enivrait de cette saison, qui apportait fraîcheur, jeunesse, joie, et le trouble de tout ce qui commence. Depuis toujours, le bonheur avait pour lui des formes multiples. L’une d’elles était l’émotion du réveil de la nature, l’imperceptible passage du sommeil de l’hiver à la splendeur des beaux jours… Marcher sur un petit chemin, un peu d’herbe tendre, les premières fleurs, quelques bouquets, puis l’explosion des couleurs. Des champs à perte de vue. Des buissons. Des sous-bois. Une légère brise sur les arbres fruitiers rose et blancs.
Du printemps, cette année-là, il n’aurait eu que de microscopiques aperçus, au hasard des rues, quand il marchait, dans le cadre, autorisé par décret, des « déplacements dérogatoires pour la pratique d’une activité physique quotidienne ». Le ravissement arrivait à lui avec les parfums exhalés des jardins, glycines, jasmins, fleurs d’orangers. Enchantement.
Comme s’il s’était agi d’un repas, il avait eu le fumet, mais avait vu le plat lui passer sous le nez. C’était triste, mais ne lui causait en définitive qu’une peine passagère.
Plus embarrassantes – sur le plan symbolique, autant que sur le plan pratique – étaient les invraisemblables mesures de police prises dans le cadre de « l’état d’urgence sanitaire ». Avait été inventée une panoplie inouïe de mesures liberticides, absolument dignes du royaume du Père Ubu. Les habitants étaient assignés à résidence – comme de très ordinaires suspects –, et devaient se délivrer des autorisations – de modernes Ausweis – pour pointer le bout de leur museau dans la rue, y compris pour aller acheter un morceau de pain ou rendre visite à un proche. Sans perdre de vue que leurs allées et venues étaient limitées à un rayon d’un kilomètre autour de leur domicile. Tout cela contrôlé par les forces de l’ordre, surveillé par des drones, enregistré par des caméras – qui permettaient peut-être la reconnaissance faciale. Tout cela admis par la population, qui s’apprêtait à s’équiper de systèmes numériques permettant aux habitants d’être « tracés », c’est-à-dire suivis à la trace – toujours comme des suspects, du bétail –, sans qu’on puisse rien ignorer de leurs faits et gestes, de leurs déplacements, des personnes rencontrées.
Habitant au bord de l’eau et sur une avancée de terre, pour ainsi dire une presqu’île, le rayon permis par la loi était pour lui aux deux tiers constitué par la mer. N’ayant jamais su, comme Jésus de Nazareth, marcher sur l’eau, il n’avait disposé, pour son « activité physique quotidienne », que d’un territoire beaucoup plus petit que celui alloué à ses concitoyens. Il se sentait lésé. Le confinement avait en fait été beaucoup plus strict pour lui que pour les autres confinés. N’y aurait-il pas eu matière à une action en justice ? S’il en avait eu le tempérament, il aurait pu, pour la beauté du geste, pour s’amuser, mêler sa voix à celles de tous ceux, victimes des événements, qui allaient demander dédommagements et réparations…
À l’infini, il aurait pu discuter des mérites comparés, des avantages et des inconvénients du mouvement et de l’immobilité. Rameuter – pour les mettre en débat – les vieux adages populaires, « pierre qui roule n’amasse pas mousse », « les voyages forment la jeunesse », expression d’un gros bon sens de base dont la valeur était évidemment variable selon les âges de la vie. Et s’il était toujours nécessaire – et utile et bon – de voyager, bourlinguer, voir du pays, de faire des rencontres, des expériences, d’échanger, bouger, il se disait aussi que l’immobilité, l’absence de mouvement, le silence, la réflexion ne manquaient pas de vertus. Il ressentait donc douloureusement l’interdiction d’aller et venir, mais s’en consolait en songeant aux avantages – nombreux – de l’absence de mouvement.
Les premiers moments, euphoriques, passés, le trait le plus perturbant du confinement avait été la transformation des relations sociales. Les autres, tous les autres, s’étaient évanouis dans une grande absence, avaient disparu, chacun chez soi. Plus de visites entre amis. Plus de lieux de convivialité, plus de cafés, plus de restaurants, plus de place du marché, plus de plage, de promenades. Plus de lieux de vie professionnelle, plus de lieux de culte. Plus de rencontres fortuites. Plus de rencontres calculées. Les espaces publics n’étaient plus fréquentés que par des passants furtifs, qui marchaient vite, pour rester en forme, préoccupés de ne frôler personne, de n’être contaminés par personne. Plus de contacts corporels – les fameuses poignées de main, embrassades, caresses, etc., désormais abolies du vocabulaire social. Comme on n’avait plus de contacts avec les autres, les autres cessaient d’exister. Plus de croisements de regards. Plus de séduction. Plus de connivence. La politesse réduite au minimum. Plus de ces petits gestes, de ces micro-rituels rassurants. Donc plus de confiance – confiance qui, autrefois, avant le confinement, avait peut-être été superficielle, mondaine, hypocrite, calculée, peu importe ; la vie était ainsi. Plus de confiance, donc de la méfiance, partout, de la défiance. Le lien social avait disparu. Donc la société s’était évanouie. Donc on n’existait plus.
En imaginant des gestes barrière, les autorités sanitaires avaient espéré arrêter la maladie : elles avaient en réalité fait barrage aux autres. Le virus, l’épidémie, le confinement avaient transformé le monde, pulvérisé la dimension sociale du monde. Ce qui avait donné naissance à un univers virtuel, d’une certaine façon efficace sur le plan pratique, mais nul sur le plan humain, sur le plan de l’émotion, nul pour donner à chacun le sentiment d’exister parce qu’il aurait appartenu à une communauté. Les échanges se déroulaient à distance, sur la toile comme on disait, via téléphones portables et ordinateurs, via logiciels et applications numériques. Il était difficile, de la sorte, de parler de société.
Face à l’importance prise par cet objet, il avait lu La Voie des masques de Claude Levi-Strauss. Livre qui invitait à ne pas dissocier la beauté d’un masque, objet hautement symbolique, de son eau matricielle, les valeurs et les mythes du groupe qui l’avait créé. Une parure de visage n’en était que l’expression et l’illustration.
Les masques imposés à chacun pour ne pas répandre au vent des villes l’abomination de ses postillons avaient une grande valeur ethnographique. Ces misérables petits morceaux de tissu, de papier ou de matière plastique – dûment normés – étaient riches d’enseignements historiques, philosophiques ; ils révélaient un moment du monde occidental, quand l’humanité avait été obligée de se calfeutrer et ne pouvait plus sortir que cachée, protégée de l’air respiré par les autres. Et si ces objets étaient sans la moindre vertu esthétique, ils n’avaient, par leur valeur symbolique, rien à envier aux plus belles œuvres des peuplades du Pacifique, d’Amérique, d’Afrique ou d’Asie, au pinacle des plus grands musées.
Le monde, le temps du confinement, était devenu une grand-scène où chacun se dissimulait. Les gens ne se cachaient pas pour jouer, séduire, intriguer, comme dans un bal masqué – derrière ces masques dansants on devinait rires, émotions, amusements de gens d’esprits ; dans un bal, un masque était un instrument délicieux qui autorisait audaces et licences. Les gens ne se masquaient pas non plus pour procéder à un symbolique, salutaire – mais provisoire – renversement des valeurs, comme dans un carnaval. Piazza à i mascari !, entendait-on aux carnavals d’autrefois, dans les villages, pour annoncer l’heure où les rues allaient être envahies de gens cachés derrière un masque, pour jouer, le temps du carnaval, un autre rôle que celui qu’ils tenaient dans la société : au carnaval les pauvres devenaient rois, et les sages étaient fous. En pandémie, les gens se masquaient par peur. Le masque acquérait une fonction sociale : il rendait légitime la méfiance de l’autre. La suspicion portée à l’autre… Aucune bienveillance a priori. Aucun doute, aucune indulgence de principe : l’autre était porteur de la maladie, du mal. Cela devenait la règle de base de la société. Son pilier. La monstruosité sartrienne redevenait d’actualité : le mal, c’était les autres. Masqué, chacun se privait des rires, des sourires, des mimiques, de tous ces riens éloquents, charmants, qui établissaient des contacts entre les personnes et soudaient une société. Là, en pandémie, on ne s’était pas masqué pour jouer, pour tenir un rôle, mais précisément pour s’abstraire de la société, pour tuer toute forme de société. Tout le monde était isolé de tout le monde : on se cadenassait sur soi, on s’enfermait. Cette sombre mascarade levait enfin le masque de la société, et montrait sa nature réelle : un égoïsme suffocant. L’enfer était bien descendu sur la terre…
Il constatait avec effroi le pire de cette situation : en venir à redouter le moment où il serait de nouveau possible de se retrouver, de se rencontrer ; n’allait-on pas craindre, universellement, de refiler la maladie à tout le monde ? Ou – ce qui n’était pas mieux – de se faire contaminer par n’importe qui, y compris par ses proches dont on avait été éloigné ? Les perspectives de retrouvailles entre êtres chers qui avaient dû se confiner loin les uns des autres – autant dire les perspectives de recommencement d’une vie normale – devenaient aléatoires, obscures, incertaines. Inquiétantes. Et laissaient craindre que se perpétuât à jamais la grisaille triste, fade que le confinement avait fait naître. Qu’à jamais on s’installât dans l’existence avachie, laide, sans séduction, sans élégance, sans relation avec plus personne, existence houellebecquienne, dans laquelle chacun était seul, isolé de tous les autres, réalité oppressante née à la faveur de l’état d’urgence sanitaire.
Il se disait que la pandémie terminée, il faudrait – ce serait un chantier immense – apprendre à ré-humaniser la vie, les relations sociales. Réapprendre à se sourire, à accrocher un regard, à exprimer avec son corps, son allure, sa manière d’être, à transmettre pêle-mêle le désir de relations avec les autres, à plaire, à faire passer l’idée qu’on appartenait tous à la même société, et qu’on n’était pas hostiles les uns pour les autres… Réapprendre à ne plus vivre en Robinson solitaire. En pestiféré. En inquiet. Réapprendre à ne pas tenir les autres pour des ennemis.
Il faudrait, pour refonder des relations sociales, se souvenir de cette évidence – fruit d’une très longue évolution de l’humanité, dont le confinement avait rappelé l’urgence –, que le moi n’était pas suffisant à lui-même, qu’il ne pouvait être sa propre fin, qu’il ne valait, ce pauvre moi pas nécessairement haïssable, qu’en relation avec l’autre, avec les autres. Il faudrait réapprendre que le moi était rayonnement, diffusion, épanchement, surtout pas repli sur soi… Sans doute était-ce la raison profonde des réflexions sur la période qu’il avait, au fil des semaines, livrées sur internet. Pour n’être pas seulement un homme confiné. Pour établir une relation avec les autres. Exister dans le regard des autres. Se donner l’illusion de n’être pas inutile. D’être, tout simplement.
Le confinement avait été sa troisième expérience d’un long moment de solitude et de silence. Autrefois, il avait accompli, tout seul, un beau voyage à pied – 1200 kilomètres, de Brest à Bonifacio – perdu sur les petits chemins, entre ciel et terre. Expérience qui n’avait pas été engagée avec ce propos, mais renouait avec l’antique tradition des pèlerinages, rupture dans le cours de la vie, ligne de partage : il y avait eu le temps d’avant, et celui d’après le voyage, abordé plus léger, plus sain, nettoyé, l’esprit plus libre. Une autre fois, il avait connu une hospitalisation au (relativement) long cours, deux mois exténué, asservi à des tuyaux et à des machines, à des examens, des soins, inquiet pour l’avenir, entouré par un personnel prévenant. Dans ces deux cas, l’expérience était comparable, voire identique : une rupture avec la vie quotidienne, parenthèse ressentie comme une libération, un soulagement ; comme une entreprise d’ascèse et de purification, qui faisait un bien fou, pareille à ce qu’on appellerait aujourd’hui une « cure de détox », pour se laver, corps et âme. Le grand confinement du coronavirus était un moment de cet ordre. Une chance.
Un risque aussi, celui de se complaire dans le confinement, qui était, dans le fond, bien commode – comme un séjour à l’hôpital, où l’on était dorloté ; on s’occupait de vous, on vous choyait… – comme un voyage solitaire, dont le but était simple, cheminer, avancer, loin des préoccupations, des tracas de la vie quotidienne. Confiné, coupé de la vie, le risque n’était pas nul de se déresponsabiliser, de redevenir un petit enfant, de donner plus exactement la parole au petit enfant qui dormait en soi, de se laisser faire… Risque que le confinement devînt une fin, qu’on ne veuille plus en sortir – parce que même si ce n’était pas très amusant, cela présentait bien des avantages. Le confinement était douillet.
Les hasards du calendrier – hasard, nom que le bon Dieu prend par modestie – avaient fait, ce printemps, coïncider confinement et carême. Cette réclusion, au moins pour le rythme de la consommation, des déplacements, de la vie sociale, était pareille à un jeûne, à un exercice de dépouillement, d’allègement, de purification, de simplification. Il espérait en sortir nettoyé, plus léger, lavé, frais, moins encombré, sans doute aussi disponible pour accéder aux formes les plus élevées de la vie, dans l’ordre spirituel. Au pardon.
Il constatait que le confinement était un moment de ressourcement, de régénération. Quel était le moteur de ce phénomène ? Le calme et le silence qui s’étaient emparés de la société ? L’obligation de vivre modestement ? Ou bien la conscience d’être en face d’une maladie mortelle qui n’épargnait personne ?
Sans doute parce qu’il était prêt à recevoir cette leçon, il mesurait combien la maladie avait révélé le peu que nous étions – tous ces gens qui partaient en quelques jours… –, et le confinement avait appris le peu dont nous avions besoin. Leçons infiniment plus utiles que toutes celles délivrées par la tranquillité et l’abondance – qui n’enseignaient rien.
Il estimait que le confinement avait été l’occasion de mesurer le prix réel des choses dont on était privé. Les unes – la majorité, dont on se passait très bien, dont on ne voyait même pas l’absence, voire dont on était heureux de ne plus être encombré – devenaient dérisoires ; d’autres, au contraire, peu nombreuses, on appréciait l’importance, la valeur. Les chrétiens orthodoxes définissaient le climat du grand carême par une expression grecque qui signifiait « radieuse tristesse » ou « tristesse produisant de la joie ». Elle soulignait que la joie véritable résultait de l’effort à se détacher des entraves matérielles. Sur ce point, il n’y avait pas d’autre joie. Certains, avait-il entendu dire, avaient transformé le confinement en compétitions culinaires, en concours gastronomiques, et pris du poids. Peut-être, estimait-il, ces paroissiens-là, en n’empruntant pas les chemins de la sobriété, étaient-ils passés à côté d’une aubaine, d’une source de joie.
Le confinement – c’est-à-dire l’arrêt de l’esprit de compétition forcené, de la consommation frénétique, de la multiplication des besoins, etc. – avait mis en avant les mérites d’une vie mesurée. Avait permis d’en revenir à une sagesse universelle qui avait nourri des générations, qui des siècles avaient suffi à nos ancêtres, « La patience est une vertu », « Se contenter de ce qu’on a est le secret du bonheur », « Qui sait se contenter de peu est toujours riche »… Règles qui reprenaient du service. Dont il espérait, du moins, qu’elles pourraient reprendre du service. Et redevenir l’âme du monde. Principes qui conduisaient à un art de vivre – proche de la vie monastique –, existence paisible, réglée, alternance de travail et de vie méditative, d’une incroyable richesse… Vie incomprise par les obsédés de la réussite, les fous l’action, par ceux qui ignoraient tout de la contemplation, de la lenteur, du silence. Ceux qui ne soupçonnaient pas de vie en dehors du travail frénétique, de l’agitation, de quantités d’argent. Lui, à ceux-là, aimait citer Jules Renard : « Ça m’est égal de manquer ma vie. Je ne vise pas. Je tire en l’air, du côté des nuages ». C’était dans ces poétiques parages que le confinement invitait à se situer. Tout y était beaucoup plus léger.
De quoi remplir un confinement léger ? Pourquoi pas de livres ? Leurs vertus, leurs charmes, étaient précieux pour aider à vivre – et prosaïquement pour supporter le confinement.
Dans l’ancien monde, quand la société était organisée par ordres, c’était les gardiens de la vie spirituelle qui donnaient les orientations à la collectivité. Aujourd’hui, les temps avaient changé, c’étaient les grands groupes industriels et financiers. Peut-être avait-on les maîtres qu’on méritait. Le confinement avait laissé entrevoir – si on avait voulu – qu’on aurait pu en revenir aux temps anciens. Ce qui eût été non seulement agréable, mais intelligent, tant il avait toujours été vérifié que l’esprit était plus fort que la matière. C’était une loi de l’évolution : survivait ce qui se reproduisait. L’esprit sans cesse se ré-engendrait. La matière – y compris quand elle était mise en œuvre par des appareils industriels gigantesques financés par des groupes financiers mirobolants –, la matière vieillissait, et mourait. Retournait en poussière.
C’était à la suite de ce constat, qu’un éditeur imaginatif avait eu l’idée de demander urbi et orbi témoignages, récits, histoires, contes, nouvelles – ce que chacun avait à proposer –, sur la pandémie et sur le confinement, matières inspirantes. Avant eux, les plus grands, Thucydide, Daniel Defoe, Albert Camus, Xavier de Maistre, Alexandre Pouchkine, sans oublier La Fontaine, avaient travaillé sur les ravages – et les leçons – de l’épidémie. Ce projet éditorial consistait à reprendre l’idée de Boccace, au milieu du XIVe siècle, quand il avait mis en scène des confinés toscans s’ennuyant dans leurs villas pendant la grande peste, et composé le Decameron. Le projet était enthousiasmant. Convaincu que ce qui se créerait pendant le confinement serait plus précieux que ce qui ne pourrait pas se fabriquer à cause de lui, il s’y était associé avec joie, et c’était ainsi qu’il avait traversé ces mornes semaines. En tenant la plume, pour tenter de donner vie à ce qui, aussi bien, n’aurait jamais vu le jour, quelques petites fleurs de printemps au bord du chemin.
Pour lire d'autres textes de l'auteur
Entamez un dialogue : écrivez-lui à notre adresse decameron2020@albiana.fr, nous lui transmettrons votre message !