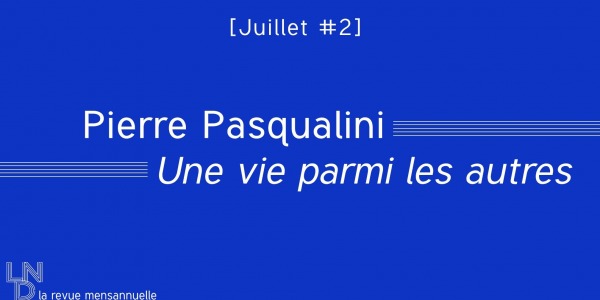- Decameron Libero
- 6 likes
- 1129 views

Pour l’homme confiné de Barcelone, les conditions se dégradent : de Charybde en Sylla sans bouger de place ! L’éclaircie tarde à venir… Une chronique d’Alain Borrat
Pour lire les épisodes précédents :
La vie au temps du confinement. Aujourd’hui : Barcelone, Jour 55.5, soir
La vie au temps du confinement. Aujourd’hui : Barcelone, Jour 66.6, après-midi
La vie au temps du confinement. Aujourd’hui : Barcelone, Jour 77.7, soir
La vie au temps du confinement. Aujourd’hui : Barcelone, Jour 88.8, matin
La vie au temps du confinement.
Aujourd’hui : Barcelone, Jour 99.9, nuit
Résumé des épisodes précédents :
Depuis le Jour 60, toutes les décisions sont prises par le Conseil Sanitaire de Guerre. Celui-ci continue à assurer l’approvisionnement alimentaire sous forme de rations livrées tous les deux matins à l’aube. Les citoyens sont maintenant dotés d’un outil adapté permettant à la Protection Intérieure de maintenir un contact sanitaire étroit avec la population. Quant à notre héros, il observe la Place. Succédant aux chiens, les goélands en ont pris possession…
Ils nous ont coupé l’eau ! Je ne l’ai pas remarqué après m’être levé, ce matin-là, parce que depuis deux semaines j’évite la salle de bain. Dès qu’on y entre on se trouve face à un miroir et son visage dedans. Comme je ne me lave plus, que je ne me peigne plus, comme j’ai décidé de ne plus me voir du tout, la salle de bain est une pièce sans utilité. Je l’ai fermée. Pour mes besoins je fais usage de ce que j’appelais les toilettes d’appoint. Dans la langue du pays on les désigne « de courtoisie ».
C’est en ouvrant le robinet de la cuisine pour préparer mon bol de café soluble que j’ai constaté que rien ne coulait. J’ai dû me contenter d’un petit pain mou accompagné de deux cuillerées de confiture. Ça avait du mal à passer.
À douze heures, j’ai entendu un gargouillis dans les tuyauteries de mon domicile. J’ai attendu un moment devant l’évier, j’ai ouvert le robinet, pour voir. L’eau coulait. Le soir, à nouveau pas d’eau. Ça m’a privé du demi-paquet de nouilles qui constitue mon repas. Heureusement, il me restait un petit pain.
Il faudra que je m’organise pour faire des réserves. J’ai passé une partie de la soirée à rechercher des récipients qui pourraient être utiles pour stocker de l’eau. J’ai libéré les caisses en plastique dans lesquels sont rangés mes disques. Ils ne me servent plus à rien, rapport à mes oreilles atrophiées qui ne reçoivent plus la musique. J’ai nettoyé avec un chiffon deux bassines et plusieurs pots de fleurs.
La porte-parole du CSG a expliqué le lendemain comment ça allait fonctionner. C’est un système assez complexe. Pour la première fois j’ai réécouté son communiqué au bulletin de vingt heures, en prenant des notes sur un bout de papier. Elle n’a rien dit sur les raisons des coupures d’eau mais a souligné le remarquable esprit de solidarité de notre population.
Dorénavant nous aurons de l’eau six heures par jour, qui sera distribuée de la façon suivante : un jour de six heures à midi, le lendemain de midi à dix-huit heures, le surlendemain de dix-huit heures à minuit, le quatrième jour de minuit à six heures, puis le cycle recommence. Cela selon les quartiers, qu’elle a terminé la porte-parole.
J’ai noté soigneusement les horaires d’eau sur mon calendrier à partir de la veille. Comme c’était de midi à dix-huit heures, il était facile d’établir une progression sur plusieurs jours. Je l’ai inscrite pour douze jours, jusqu’au 101. Par exemple, ça m’a permis de savoir que le lendemain j’aurai de l’eau de dix-huit heures à minuit et que je pourrai préparer les nouilles. Ceci facilite aussi bien évidemment le remplissage des récipients pour constituer une réserve. Il faut penser à la chasse d’eau.
C’est tout de même inquiétant, ces coupures d’eau, ça pose questions. Il faut admettre qu’à l’exception des ordinateurs et des téléphones rendus hors service depuis le Grand Bug du Jour 9, les services domestiques étaient jusqu’à présent assurés en toute normalité. L’eau et l’électricité fonctionnaient de la même manière qu’avant le confinement.
La raison de cette soudaine restriction n’ayant pas été explicitée, on est en droit de se demander si les employés, les ouvriers, techniciens, ingénieurs en charge de la distribution de l’eau ne sont pas à leur tour strictement confinés comme l’ont été vraisemblablement les préposés du ramassage des ordures. Dans cette hypothèse, on peut supposer qu’un service minimum a été mis en place, mais jusqu’à quand ? Ma programmation sur douze jours n’est-elle pas trop optimiste ?
Il n’est pas interdit de penser qu’un même phénomène pourrait se produire avec la distribution de l’électricité. Je me suis empressé de vérifier mon lot de bougies. Je pourrai tenir plusieurs soirs, mais j’aurai bonne mine à vouloir cuire les nouilles sur la plaque électrique sans électricité.
Et la radio ? Non, ils ne peuvent pas nous couper le courant. Ou alors le remettre juste pour treize heures et vingt heures, aux moments du communiqué d’information. Ou nous fournir des piles dans le paquetage. Remarque, ils pourraient tout aussi bien l’envoyer sur l’outil adapté. L’important est de maintenir un lien régulier avec les citoyens dans le souci permanent de notre sécurité. Mes doigts répondent NON les yeux fermés aux six questions quotidiennes(*).
J’éteins mon transistor juste après la communication de la porte-parole du CSG, à treize heures dix. Ça va bien comme ça. Ça me provoque chaque jour un sentiment touffu où se mêlent colère, impuissance, tristesse, manque de réconfort, désespoir. Il me faut toujours pas mal de temps pour m’en remettre.
L’autre jour, je me suis risqué à répondre à la curiosité que je m’interdisais : j’ai écouté la radio après treize heures dix. Le programme est surréaliste. Il s’agit de la rediffusion des retransmissions de matchs de football qui ont marqué l’histoire de notre pays. J’ai écouté un bout de la finale de la coupe 1967. À la mi-temps, le score était d’un but partout, je me suis arrêté là. Ça ne m’intéressait pas de connaître la couleur du maillot du joueur qui recevrait le trophée des mains du caudillo.
Ce qui m’intéresserait ce serait de savoir ce qui se passe au-delà de la Place, ailleurs. Savoir si les Fidjiens continuent à jouer au rugby, si les marchés des villes-oasis du Sahara sont toujours le lieu d’interminables marchandages en se tenant la main, savoir si à Bruxelles les gens vont aux concerts et boivent de la bière dans les estaminets, si à Abidjan, à Douala, les samedis soirs, des femmes belles comme la nuit remuent leur derrière dans les bras de gars sapés comme des milords. Savoir si la pandémie a arrêté la guerre en Syrie la guerre au Yémen la guerre dans l’est du Congo la guerre en Lybie, si les habitants de Ramallah survivent encore plus confinés ou plus confinés du tout. Savoir si la mer est toujours là, si la vie est toujours là, quelque part. Le monde est devenu tellement local !
On nous dit rien…on nous informe vraiment sur rien…plus on ne sait rien…C’était le refrain d’une chanson du siècle passé.
Ça s’est fait plus très facile de prendre des nouvelles de la Place à travers la fenêtre. À cause des drones. Ils m’emmerdent ceux-là. Ils ont été largués par l’hélicoptère ça fait une bonne quinzaine de jours. J’en ai compté quatre. Et vas-y que je te papillonne, que je te bourdonne, que je te vrombis, que je te vibrionne à longueur de journées. On leur a réparti leurs emplacements : c’est chacun son côté de la Place. Quatre côtés, quatre drones.
Leur chemin ne varie pas. Ils commencent par un coin, au niveau des appartements d’en haut, puis ils descendent jusqu’au rez-de-chaussée et passent à l’immeuble contigu. Quand ils sont arrivés au bout de leur côté, ils vont se repositionner à leur point de départ et c’est reparti pour un tour. Toute la journée comme ça. C’est pas bien rusé un drone, faut reconnaître. Mais méfiance tout de même.
Si ce n’était que ce ballet aérien mélangé à celui des goélands, on finirait par s’y faire. On se fait à tout depuis quatre-vingt quinze jours. Là où c’est franchement moche c’est que devant chaque fenêtre de chaque immeuble, le drone stationne une quinzaine de secondes. On l’entend bien le vrombissement. Y’a intérêt à avoir la fenêtre fermée parce que dans le cas contraire, il t’envoie un rayon lumineux vert à travers ton salon, pareil que dans les films de science-fiction, et c’est pas une bonne idée de se retrouver en face.
Conclusion : il faut vivre fenêtres fermées et ne voir le monde minuscule qu’à travers les vitres. Le rayon vert ne se déclenche pas quand les vitres sont fermées. Ou alors il faut être malin.
J’ai calculé qu’une rotation de drone de mon côté d’immeubles dure onze minutes et quarante trois secondes. Ça me laisse une grosse dizaine de minutes pour ouvrir la fenêtre afin d’aérer mon domicile. En réalité je ne l’ai fait qu’une fois. À cause des grosses mouches noires qui s’engouffrent. À cause des criailleries insupportables des goélands. À cause de l’odeur à faire vomir qui s’élève de la place. Il fait chaud. Depuis trois mois mon logement est autant mon abri que ma prison.
Cela m’a amené, les drones, à modifier mon poste d’observation. Je me place un peu de côté par rapport à la fenêtre, jamais dans l’axe. Je soulève un pan du rideau et je sais qu’à partir du moment du passage du drone j’ai onze minutes. Je me livre à cette opération plusieurs fois par jour.
La jeune voisine d’en face, la plongeuse au maillot de bain bleu et au bonnet blanc(*) a fait des émules. J’ai compté hier matin cinq cadavres déchiquetés sur la Place. Avec toutes ces nuées d’oiseaux qui les dépècent avec voracité, il est n’est pas possible de distinguer entre hommes et femmes. Une chose est certaine c’est que deux corps sont l’un à côté de l’autre : celui d’une personne adulte et autre plus petit, celui d’un enfant. Je suppose que l’adulte a plongé avec l’enfant dans ses bras. Pain bénit pour les goélands, qui me semblent être de plus en plus nombreux et comme sous l’emprise d’une perpétuelle frénésie. Il y a aussi quelques dépouilles de chiens dont il ne reste plus grand-chose, des touffes de poils, des chapelets d’os.
Je dois être honnête avec moi-même : l’idée de faire à mon tour le saut de la mort me taraude parfois. Y a-t-il une autre issue envisageable lorsque le dernier tout petit souffle d’espérance s’est éteint ? Lorsque la porte-parole du CSG annonce que les mesures d’urgence ne semblent pas devoir prendre fin dans un avenir proche car nous n’avons pas encore atteint le pic de la pandémie mais nous sommes sur la bonne voie.
Je n’habite pas assez haut, au pire je risquerais de me briser le bassin ou me fracturer une clavicule. Ce qui revient à finir les organes dépecés par les goélands. Pas glorieux et douloureux, j’imagine. Très lent. Faut être sûr de son coup.
Quelqu’un qui n’aura plus ce genre de pensées, c’est ma voisine. Ou mon voisin, l’un des deux mais je ne sais pas lequel avec certitude. Ça s’est passé vendredi soir peu après l’appel de l’outil adapté. Le suraigu de la sirène d’une ambulance était tout proche, du côté de ma chambre. J’ai assisté à travers la fenêtre à la scène déjà observée des deux ASS avec leur brancard. Cette fois-ci ça concernait notre immeuble.
Des pas pressés dans l’escalier, une sonnerie toute proche. J’ai collé mon oreille à la porte d’entrée, celle qui donne sur le palier, en face de celle de mes voisins.
Quelques paroles lancées comme des ordres. La voix de mon voisin, celle de ma voisine, fortes. Des bruits comme une lutte et puis une porte qui se ferme. D’autres bruits qui provenaient maintenant du palier, il me semblait que j’aurais pu les toucher. J’ai perçu comme un gémissement, puis le son un peu feutré d’une sangle que l’on serre et un clic métallique. À nouveau les pas pressés dans l’escalier mais dans le sens de la descente cette fois. Le brancard a été rapidement jeté à l’arrière de l’ambulance. J’ai eu le temps de distinguer une forme cylindrique sous le grand sac en plastique blanc. L’ambulance, dont la sirène perçait toujours les tympans, a vite démarré. C’était à peu de choses près le même procédé que celui de la Nuit des Chiens(**), j’ai constaté. Les brancards remplacent les laisses.
J’ai cette curieuse conviction que c’était la voisine, pas le voisin. Que peut-être par mégarde, un instant d’inattention ou d’énervement ou de lassitude, elle a appuyé sur OUI à l’une des questions de l’outil adapté. Si c’est le cas, ça ne pardonne pas. J’avais flairé ça dès le départ que l’erreur serait fatale, ce n’est vraiment pas pour me vanter.
Où l’ont-ils amenée ? Où les amènent-ils celles et ceux qui ont perdu le sens du goût des nouilles insipides ? Qui actionnent la mauvaise touche ? Mon voisin reverra-t-il sa femme ? S’agit-il d’une opération planifiée d’élimination? Les indépendantistes en seraient évidemment les premières cibles.
Cette nuit-là, je n’ai pas voulu prendre de gélule alors forcément je n’ai pas pu m’endormir. Les goélands, les tourments, les cadavres de la place, la voisine, tout ça. Au cœur de mes pensées noires tournait en boucle ce regret de n’avoir pas répondu au mot que j’avais trouvé sous ma porte quelques jours avant, c’était écrit sur une feuille de mon carnet orange : « Ça va ? Tu as besoin de quelque chose ? ». Je suis hanté par l’idée que j’aurai à vivre désormais avec cette négligence.
Je n’ose pas frapper à la porte du voisin, ni même lui écrire un petit mot de soutien.
Il est stupéfiant de constater la rapidité avec laquelle on peut en arriver à ne plus souhaiter le moindre contact humain. À ne plus en être capable. Comme si cela était devenu impossible de communiquer avec autrui. Ça m’est devenu impossible, je crois bien.
Demain ce sera le centième jour du confinement. Cent jours ! Qui aurait pu imaginer un tel bouleversement aussi brutal dans nos manières de vivre? À en arriver à se demander ce qu’a de « vivre » le déroulement morne de toutes ces journées identiques. On se raccroche à ce que l’on peut encore grappiller, avec de plus en plus de peine à imaginer, à se projeter. Il est inconcevable que notre civilisation ne puisse pas s’en remettre, je me dis pour m’en persuader. Cela sera difficile, cela prendra beaucoup de temps, de bonnes volontés, d’intelligences. Nous finirons bien par l’entrapercevoir, la lueur qui vacillotte au bout de l’interminable tunnel.
Songer à cela m’évite de me conclure sous les coups de bec des goélands en bas. Pour le moment c’est ça que j’me dis. C’est plus ça.
Je ne sais pas si c’est sa façon de célébrer les cent jours, au CSG, mais aujourd’hui, le dernier de ceux à deux chiffres, j’ai remarqué deux modifications à l’ordre établi.
Primo : les drones n’ont pas été là de la journée.
J’ai pu en fin d’après-midi ouvrir la fenêtre, geste qui a été mis à profit par une demi-douzaine de grosses mouches noires pour s’engouffrer chez moi. L’odeur qui m’est arrivée du dehors était intolérable, j’ai refermé bien vite. Il faut maintenant que je fasse la chasse aux mouches. J’avais pas pensé à ça.
Deuzio : cette nuit, pour la première fois depuis trente-sept jours les lumières des quatre check points qui encadrent la Place sont éteintes.
Et s’ils avaient des difficultés à assurer les relèves ? Et si… Il est bien tard.
Je viens d’avaler deux gélules. À chaque jour suffit sa peine.
Alain B., Jour 99.9 …………2020
(*) Voir l’épisode : le Jour 88.8
(**) Voir l’épisode : le Jour 77.7
Entamez un dialogue : écrivez-lui à notre adresse decameron2020@albiana.fr, nous lui transmettrons votre message !