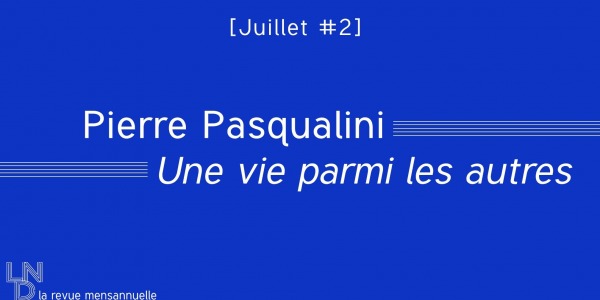- LND 2024 - Septembre
- 1 likes
- 4795 views

Yves Rebouillat prête sa plume à Louis, qui nous conte la vie ordinaire d’un homme ordinaire… Un être unique pourtant… Un père.
Un père
Ce soir-là, le Pays célébrait la bonne entente entre voisins. L’ambiance festive facilitait les rapprochements. Louis, que je ne connaissais pas, engagea poliment la conversation en me questionnant sobrement à propos de ma nouvelle vie sous les cieux de Provence, puis lentement, adroitement, enchaîna sur ce qui allait devenir le récit fragmentaire et déstructuré de la vie d’un homme. Il semblait détenir des informations sur moi que je n’avais pas sur lui. Peu importe comment il s’y prit, je l’ai écouté avec curiosité puis intérêt. Il tenait à garder vivants et à transmettre les souvenirs qu’il avait de son père, mari amoureux jusqu’à la fin d’une femme très jolie et un peu effacée.
Selon lui, Édouard avait été un homme généreux, joueur, tricheur, protecteur, menteur, menaçant, porté sur la boisson, aimant les copains, les parties de pétanque, pétri d’idées reçues desquelles il pouvait, sous bonne influence, se défaire. Sa condition sociale et sa culture lacunaire obscurcissaient sa compréhension du monde en même temps qu’il désapprouvait l’usage de l’argot et des grossièretés de langage, savait bien écrire et calligraphier – je pus vérifier sur pièces. Il était physiquement vigoureux, craint, sachant où et comment frapper pour neutraliser les importuns cherchant querelle. Son casier judiciaire était resté vierge malgré un bon nombre d’heures passées dans des cellules crasseuses de quelques postes de police des villes où il s’était déraisonnablement conduit. Des plaintes furent déposées contre lui, qui ne connurent aucune suite.
Louis, son fils, voulait-il rendre hommage à un père aimé et détesté à la fois, mort dans sa quatre-vingtième année, six mois tout juste après son épouse ? Deux disparitions dues aux mêmes causes – un accident de la route aux effets, l’un immédiat, l’autre différé – qui eurent pour autre conséquence de lui déchirer l’âme parce qu’il n’avait pas été présent à leurs côtés les mois qui précédèrent l’événement fatal et ne leur téléphonait plus. Ainsi n’en finissait-il pas avec le puissant malaise qui le tenaillait depuis l’enfance, né d’un trop-plein de ses deux parents, épuisant, destructeur, d’un excès de pressions et d’exigences auxquelles il n’avait jamais su mettre le holà. Il avait bien tenté d’y échapper, en évitant de les voir pendant des périodes de plus en plus longues tandis que leur santé se dégradait. Il avait quelquefois envisagé, de regrettées fractions de seconde durant, que leur mort apaiserait ses tourments, ce qu’elle ne fit pas ; une chape de plomb faite de remords, de reproches et de honte s’abattit sur lui au premier décès.
Alors que la fête du quartier battait son plein, que nous étions assis tous les deux sur un banc, en retrait du vacarme et que nos compagnes dansaient en compagnie de nos amis et de nos voisins, Louis me conta cette histoire ordinaire enchâssée dans le siècle passé. Il le fit sans doute parce qu’il savait que j’écrivais des articles, des portraits, des chroniques pour des journaux, des blogs sur des réseaux sociaux, et parce que je jouissais, dans un petit périmètre, d’une réputation de bienveillance à l’égard d’autrui et d’écoute patiente. Ressentait-il une urgence à dire ce qui, sans cette initiative, ne serait jamais connu ? La fièvre qu’il mit dans sa narration n’était pas pour rien dans mon écoute attentive.
Pris au jeu d’entendre pour rapporter – un vice d’auteur – et soucieux d’authenticité, je lui proposerai, à la fin de la soirée, un rendez-vous que j’obtiendrai pour compléter et peut-être revenir sur ce que j’aurais retracé. Je le revis donc au cours d’une petite matinée. Je n’ai rien enjolivé, ni comblé aucun trou de ce curieux et inattendu récit – improvisé à voix haute, débridé, jamais inintelligible – avec ce qu’il m’aurait plu d’inventer. Ni cherché à relier de façon romanesque des scènes, des tableaux, des flashs. J’ai respecté le choix du narrateur initial de suivre ce seul fil rouge : dévoiler des facettes de ce père dont il n’arrivait pas à chasser les ombres qui l’encombraient encore des années après sa mort, comme si son exposition aux regards d’autrui devait écarter le revenant ou le rendre plus digne à ses yeux. L’auteur concocte en sollicitant son imagination, le témoin rapporte et ne met dans ce qu’il retrace à sa manière que ce que lui autorisent sa mémoire et sa bonne foi.
Une semaine après l’avoir entendu sans presque l’interrompre ce samedi soir et le surlendemain, je lui remis un texte imprimé que je conservais plié dans une poche (ne connaissant rien de lui qui pût me dire où il demeurait et ayant peu de goût pour l’enquête de police), convaincu que nos chemins se croiseraient et qu’il attendait sûrement ces quelques mots. Ce fut mon dernier contact avec cet homme guère plus âgé que moi et dont je ne sais quoi penser. Je me demande comment ses propres enfants – s’il en a – parleront de lui. J’avais noté en toute fin d’entretien à quelque chose dans son attitude, son regard, qu’il s’était apaisé, comme libéré d’un fardeau, et me vint à l’esprit qu’il pressentait sa propre mort.
¤¤
Dans la vieille maison attenante au presbytère et à la salle des fêtes paroissiale aux fauteuils fatigués de velours rouge et où trônait un imposant piano droit désaccordé, face à la grange où reposait le vieux corbillard à cheval, au fin fond de la Bourgogne pauvre, avec un père, Joseph, qui avait descendu les barreaux de l’échelle sociale et une mère, Marie, dépressive, impuissante à donner de l’ambition à son mari, et deux jeunes sœurs, la vie était difficile. Le curé du village avait, matériellement, beaucoup fait pour aider la maisonnée à survivre.
Pratiquant le jeu de tarot dans les bistrots jusqu’au petit matin, peu fait pour le commerce, rétif à l’effort prolongé, Joseph, né dans l’avant-dernière décennie du XIXe siècle, le grand-père de Louis, le père d’Édouard, avait fini par ruiner la boulangerie que son père – qui n’avait jamais douté de ce qu’il arriverait – lui avait laissée en héritage.
Pour faire vivre sa famille, il fit de mauvais gré sa reconversion dans l’extraction de pierres dans la carrière proche. Il vécut longtemps, mal. Puis sale, après le suicide de sa femme, mais généreux avec les fripouilles qui lui volaient l’argent de ses modestes pensions. Édouard avait essayé d’y mettre fin et d’obtenir des remboursements, mais cela n’avait rien donné et ses deux sœurs, les tantes de Louis, n’y purent rien non plus. La presse locale avait écrit sur ces mêmes malandrins, sordides détrousseurs de vieillards désorientés, finalement jugés et condamnés.
¤¤
Édouard n’aimait pas l’école à moins qu’il pût y jouer à sa guise. Il s’y employa sous les regards complaisants du vieil et sévère instituteur. Tous les deux s’appréciaient, l’enfant parce que le maître le tenait en grande estime, celui-ci parce que le gamin était audacieux et que l’enseignant avait toujours été timoré, hormis lorsqu’il donnait à ses élèves des coups de règle sur les doigts, des baffes et des coups de pied quelque part. Édouard avait raconté une inspection attendue que l’enseignant avait préparée avec ses élèves de façon à limiter les risques de dérapage. Louis ne se rappelait plus clairement le stratagème que son père révéla à l’inspecteur à l’issue immédiate de son contrôle. Au départ de ce dernier, l’avoinée fut exceptionnellement sévère, mais l’enfant n’alla pas se plaindre à son paternel qui lui en aurait administré une plus lourde encore.
Édouard quitta le foyer à quatorze ans et trouva à s’embaucher – mû par atavisme – chez un boulanger dans la banlieue de la grande ville. Il apprit, dans la douleur, à faire le pain, les viennoiseries et les brioches. Les sacs de farine étaient lourds, les horaires, le travail, éreintants. Mais son patron prit l’apprenti en affection et sa bienveillance provoqua un miracle : le garçon se révéla courageux, devint concentré sur ses tâches, patient, perfectionniste, ponctuel, professionnel.
Il grandit, devint un homme élégant, portant ses cheveux courts au-dessus des oreilles et sur la nuque, longs sur le crâne, rabattus en arrière, à la zazou. Pardessus de feutre sombre, pantalon large, chapeau genre Borsalino, la photo que Louis conservait le magnifiait. Il eut bien des aventures avec des femmes qui prirent fin quand il rencontra la belle, trop faible et imméritée Noëlle.
Dans la journée, il pratiquait la boxe où il excellait et le vélo, une passion de toujours. Ses entraîneurs, de grande foi en son potentiel de champion, plaidaient avec énergie pour qu’il abandonnât l’une de ses deux disciplines contradictoires : le vélo lui faisait se refermer les épaules sur sa cage thoracique, la boxe réclamait qu’il fît travailler ses pectoraux et ses bras ; les entraînements au combat densifiaient son entière musculation, le rendant trop lourd et moins « aérodynamique » pour la bicyclette, mais pas question de se ranger aux raisons de l’un ou à celles de l’autre, il aimait pédaler et se battre.
Il fit jeu (presque) égal avec de futurs champions français dont le célèbre poids plume, Ray Famechon. Puis renonça à l’art pugilistique après avoir disputé et perdu un match surclassé de deux catégories – subterfuge mis en place par l’organisateur de la soirée pour répondre à des défections de combattants et faire durer le spectacle qui menaçait de mal finir. Édouard ne voulut d’abord pas participer. Une enveloppe de billets d’un montant qui excédait deux semaines de boulange modifia le cours probable de la soirée. Il subit une telle correction que l’envie de ring cessa sur-le-champ. Il lui restait d’autres occasions de donner et de recevoir des coups.
¤¤
La guerre, l’occupation nazie et le temps de la collaboration avec l’ennemi survinrent. La désobéissance tempérée lui fut un premier réflexe. Il aimait insulter en argot et avec le sourire les officiers allemands qu’il croisait parfois dans la boutique. À dix-huit ans, il devint « messager » à quelques occasions pour le compte de la Résistance, mais sans mise en grand danger de sa vie.
Quand les forces alliées et l’armée du maréchal de Lattre de Tassigny libérèrent sa ville en septembre 1944, Édouard s’engagea contre les nazis « pour la durée de la guerre » et participa à la campagne d’Allemagne, tua, y fut blessé. Il garda longtemps un pistolet Walther P38, trophée pris à l’ennemi dont il se débarrassa quand il prit conscience – les enfants qu’il eut avec Noëlle grandissant, leur curiosité aussi – qu’avec un chargeur garni de balles qui traînait dans une cantine rangée au grenier, il pouvait être à l’origine d’un drame domestique.
La clause contractuelle funeste qu’il avait acceptée l’envoya en Indochine se battre contre des inconnus à l’égard desquels il n’éprouvait ni prévention ni la moindre haine : ils n’étaient pas allemands et n’avaient pas commis d’exactions dans le pays. Le baratin sur la guerre qui se poursuivait en Extrême-Orient ne fit pas illusion très longtemps. Cependant, Édouard ne fut pas au nombre des hommes qui, avant d’arriver à Marseille ou en y parvenant, désertèrent, sensibles aux explications du mouvement anticolonialiste et aux mots d’ordre du parti communiste, également peu désireux de perdre la vie pour une cause injuste, un motif fallacieux.
Mais il était immature, politiquement ignorant, un peu tête brûlée et le voyage sur un « Liberty-ship » américain promettait d’être fantastique : des jours de farniente et de mer, de soleil, loin de la désormais routine artisanale boulangère. Il laissa un carnet de route – Louis m’en fit voir des photographies –, sorte de journal dont les pages étaient couvertes d’une jolie écriture serrée qui rapportait les plongeons, depuis le bateau, le canal de Suez, et les dauphins accompagnateurs. Il contenait un guide manuscrit de conversation élémentaire en anglais, une nombreuse collection de prénoms de femmes auxquelles il prévoyait d’écrire, y compris ceux de ses sœurs ; il était illustré de joyeuses pensées et retraçait les événements quotidiens. Les heures qui suivirent le débarquement en Indochine furent un choc. Très vite, les combats et des copains de croisière tués. Après l’énumération lapidaire de quelques morts, les feuillets suivants restèrent désespérément blancs.
Il fut pendant trois ans un héroïque sous-officier d’infanterie de marine, un « marsouin », bien entraîné, totalisant une vingtaine de sauts en parachute, le cœur et la tête chavirés par les atrocités commises par les troupes coloniales françaises et les partisans du « Viet-Minh », combattants de la libération nationale du Vietnam.
De retour au pays, Édouard dut se réadapter à la vie civile. Il ne pouvait plus dormir dans un lit qui « l’engloutissait », le sol était rassurant, son inconfort limitait la durée de ses cauchemars. Il voulait tout oublier : la jungle, les rizières, les boues, les villages, les faubourgs, les bouges et les bordels des villes, les sangsues, les insectes, les souricières, les combats, l’odeur du sang, la mort, les compagnons partis… Il avait besoin d’un sas de régénération. Il devint, dans le village de son enfance, travailleur au grand air, cantonnier, bûcheron, manœuvre, avant de pouvoir retourner, des mois plus tard, à la « civilisation », chez son premier employeur qui le reçut avec sa femme, les bras ouverts et les larmes aux yeux.
Il reprit les sports, la fréquentation des copains, les sorties, les bals et la fabrication des pains et des viennoiseries la nuit… Il y eut le mariage au printemps 1949.
¤¤
Lors de leur seule incursion dans le grenier de la maison où leur père avait grandi et où ils furent, ses sœurs et lui, autorisés à fouiller, Louis découvrit à douze ou treize ans, une boîte « précieuse » qui contenait trois agates, une photo de femme, la marraine de guerre du soldat Édouard, la Croix de guerre et la médaille militaire du grand-père Joseph, ancien poilu héroïque de la « Grande Guerre » et le « Carnet d’Indochine ».
Son curriculum de soldat présentait « bien » : blessé une première fois au bras par balle en Allemagne, une seconde par un éclat d’obus à la jambe en Indochine, ayant atteint le grade de sergent-chef, décoré pour bravoure comme son père (ce dernier, avec palmes), de la Croix de guerre, plus tard de la médaille militaire (comme son père).
Son futur beau-père Émile, militaire lui-même, qui ne voulait pas pour gendre d’un ouvrier boulanger travaillant jusqu’« à pas d’heure », l’avait fortement encouragé à poursuivre une carrière dans l’armée. Il obtempéra et sans doute regretta. Changea de corps, devint bureaucrate dans un « service technique », ne porta plus l’uniforme qu’à l’occasion de stages obligatoires ou pour d’inévitables cérémonies.
Le couple eut ses deux premiers enfants en Allemagne, où au bord du Rhin, ils découvrirent les avantages accordés à une armée victorieuse et d’occupation ainsi que la qualité résiduelle encore excellente du système de soins allemand dont profitèrent Noëlle, tombée gravement malade, et Édouard qui put faire réparer ses deux mâchoires qui avaient perdu leurs incisives à la suite d’un accident de vélo et dont les conséquences avaient été mal réparées en France.
Après un détour par le Maroc, une nouvelle grossesse, une terrible dysenterie infantile qui faillit tuer mon interlocuteur, ils rentrèrent au pays, pour une nouvelle hospitalisation de Noëlle et la naissance d’une « petite dernière ». Ils connurent l’habitat précaire ; l’armée n’était pas bonne fille à l’égard de ses héros. Courageux et dans le besoin, il mit en place deux immenses potagers pour que tous mangeassent à leur faim, accessoirement pour égayer un endroit lugubre au cœur d’une antique enceinte militaire menaçant ruine et qui avait dû connaître de bien médiocres bâtisseurs. Il initia son fils à la culture : il ne s’agissait que de nommer les plantes et d’arroser celles se trouvant en bordure d’allées. Louis fut fasciné par le bel ordonnancement du tout lorsque les rangées de pieds de tomates donnèrent leurs fruits, les petits pois se répandirent autour de leurs perches et les fanes touffues des pommes de terre révélèrent tant de tubercules qu’on en oubliait toujours quelques-unes dans la terre, couverte par ailleurs de salades, de feuilles de carottes, de poireaux et de pieds de courgettes aux splendides fleurs orange et jaune.
Édouard échappa à la guerre en Algérie. L’un de ses jeunes beaux-frères y fit son « service militaire », en revint indemne et n’embrassa pas la carrière. Bienheureusement, cette folle série familiale prit fin.
En marge de la guerre d’Algérie, Édouard participa à des rixes urbaines et nocturnes opposant « commandos gaullistes » et activistes de l’OAS. Il était partisan du « chef de la France Libre » depuis l’occupation et le resta plus ou moins jusqu’à la mort du général. Ce qui ne l’empêchait pas de voter communiste aux élections municipales parce que le maire de sa commune aidait les clubs sportifs, joueurs de pétanque compris.
La révolte de la jeunesse et les grèves ouvrières de mai et juin 1968 contribuèrent à développer son sens critique comme jamais aucun événement ne l’avait fait. Et particulièrement sa répulsion à l’égard des flics antiémeutes qui lui rappelaient des heures sombres et dont il voyait les camions lugubres stationner sur le terrain des jeux de boules de la ville. Quelques-uns de ses préjugés reculèrent, son refus des différences se défaisait.
¤¤
Les étés, les parents louaient de grandes maisons où la famille résidait deux mois durant, Édouard restait deux semaines, repartait, revenait deux semaines, rentrait pour assurer son service et revenait les week-ends. Leur mère, fatiguée de tout, attendait son retour. Autoritaire avec ses enfants, elle leur avait imposé la sieste jusqu’à l’âge avancé des douze ans de l’aînée. Une façon de se débarrasser d’eux une petite heure combinée à une obligation d’hygiène de vie.
À son retour, le père expliquait comment il se débrouillait pour voyager sans billet de chemin de fer en se dissimulant et en débitant des sornettes aux contrôleurs qu’il croisait, plus confiants, plus crédules ou moins avertis que le seraient devenus leurs successeurs. Il faisait cela pour le sport parce que les réductions de prix sur les billets SNCF dont il bénéficiait rendaient l’usage du train très avantageux. Louis se demandera plus tard, avec ses sœurs, à quel point tout cela – comme d’autres micro-aventures – était vrai.
À la plage, en Bretagne-nord, où peu de monde se pressait, ils allaient, lourdement équipés. Coupe-vent, marmite norvégienne de l’armée, tables et chaises de camping occupaient le vaste espace dont la famille avait besoin sans nuire à d’autres touristes. Les vacances à la montagne obligeaient la famille à réduire le volume des équipements transportés, mais le service était toujours très performant. Mer, montagne, campagne, les parents n’ont jamais lésiné sur la qualité des vacances prises en famille.
Il faisait des cadeaux à ses enfants et se débrouillait pour gruger les commerçants. Louis se rappelle comment, choisissant parmi trois cerfs-volants étalés sur un comptoir, son père paya le plus petit puis s’esquiva avec le plus grand.
Édouard outillé d’un simple couteau fabriquait des sifflets dans des branches de noisetier. Avec des ciseaux à bois, il sculptait des bateaux à voiles, équipés de multiples accessoires et capables de naviguer sur les mares et les petits cours d’eau. Il fabriquait les objets très vite après avoir passé plus de temps à choisir le bois des carènes, les bonnes branches dont seraient faits les arcs et les flèches avec empennage, les cannes de marche aux dessins tracés dans l’écorce.
Il donnait un aperçu de sa force spectaculaire et de la fierté qu’il en retirait en servant, seul, de base solide à une tour humaine au sommet de laquelle se hissait Louis dont la mère se détournait pour ne pas assister à cette stupide démonstration qui pouvait mal finir.
Profitant parfois de ses retours au domicile sans charge de famille, il faisait des bringues avec des copains et des membres de la grande famille. Cela finissait par se savoir. Louis l’apprit. Il avait au moins deux tantes et un oncle qui aimaient bien lui faire part de l’inconduite de ce père dont il se désolait. Il détestait ces pitoyables mouchards dont la mort le laissa de marbre. Il avait aussi des oncles et des tantes prévenants, qui le rassuraient et qu’il aimait beaucoup.
¤¤
La famille fonctionnait plus ou moins bien. Beaucoup mieux que ce qui se laissait voir et entendre dans les cités où ils vécurent.
Les enfants firent leurs communions privée et solennelle ; le fils cessa, presque aussitôt après la dernière contrainte, la fréquentation de la messe les dimanches. Ses sœurs continuèrent un temps, l’aînée qui encadrait des jeunes catholiques et la cadette qui était… plus jeune.
Ils connurent de merveilleux dimanches quand les repas étaient toujours succulents et les parents tranquilles. Au père, le soin d’inventer les entrées et de cuisiner les plats de viandes grillées ou poêlées ou de poissons toujours en sauce, les gratins et autres préparations de légumes ; à la mère, la confection des desserts.
Le samedi était souvent l’occasion de manger des « frites » et les meilleurs morceaux de bœuf : araignée, filet, bavette, entrecôte, poire, hampe… Il y eut un long épisode « steak tartare », un autre, « tournedos », et même une péripétie « viande de cheval ». Édouard avait un grand ami boucher, un autre qui vendait des couteaux. Un troisième lui avait façonné, dans une épaisse planche de chêne, un billot à découper dont Louis se servait encore. Il se faisait plaisir mais il avait bien plus à cœur encore de gâter sa progéniture, la mère n’était pas gourmande et avait la viande en horreur.
La balade en forêt le dimanche était un rite. La cueillette des champignons, une course aux trésors qui nourrissait des projets de sauces et de fricassées avec ail et persil.
Dans la grande famille, Édouard avait la réputation d’être un excellent cuisinier, le meilleur en son sein et bien du monde aimait déjeuner ou dîner à la maison. Il ne redoutait pas d’organiser de grandes réceptions et donnait beaucoup de sa personne à cet effet, sauf pour les gros gâteaux à la crème qu’il commandait au pâtissier quand Noëlle n’était pas disposée à en fabriquer.
Gourmand, il forcit, fut moins séduisant. Ce n’était pas un sujet de débat, son embonpoint, ses rondeurs de père rassuraient.
¤¤
Mon attention faiblissait, cela faisait trop d’heures que je me concentrais sur une histoire qui n’était pas la mienne, mon interlocuteur me priant de la bien comprendre, tout en s’enfonçant dans la nostalgie et le tourment. Il était insatiable. Son père revivait dans son cinéma intérieur. Il était temps que nous nous séparassions. La fête prenait fin, ma compagne était depuis longtemps revenue puis repartie. Alors que je fis mine de me lever, Louis accéléra son débit pour me faire rapidement ses dernières confidences. Mais je saturais et lui proposai de poursuivre le surlendemain. Son débit s’alentit, il ferma les yeux, me remercia, se leva et s’en fut sans façon.
Lundi, Louis reprit comme s’il venait de s’interrompre. Je ne le sollicitai finalement pas pour reprendre tout ou partie des épisodes déjà évoqués : il ferait, pensais-je, la relecture soigneuse de mon texte et me dirait. Je me trompais. Après remise de mon projet, je ne le revis jamais.
Je pense qu’il voulait partager l’histoire de son père qui lui en avait fait tant voir, mais, qu’au fond, il ne pouvait s’empêcher d’aimer. J’avais compris que le fils était venu rejoindre ses parents dans le Var après l’accident. Définitivement.
¤¤
Édouard avait à cœur la protection de sa famille, mais il la comprenait mal. Il ignorait les soifs de libertés de mouvement, de pensée, de comportement et d’allure qui s’y manifestaient. Face à l’insistance de ses enfants, il pouvait hausser le ton et user d’arguments idiots pour imposer ses points de vue et décisions.
La mère intervenait peu dans ces conflits. Bien souvent elle le rejoignait dans ses inquiétudes et redoutait qu’il arrivât quelque chose à ses gamins : maladie, agression, accident… Jusqu’à ce que chacun eût atteint l’âge de seize ans, ils ne sortaient guère seuls, elle les avait partiellement mis sous cloche. Et les emmenait le mercredi le long des rues de la ville moche en direction d’espaces de verdure. Des sorties sans joie ni intérêt. Noëlle se donnait bonne conscience.
Elle aurait eu besoin de passer son permis de conduire et de se lier à d’autres personnes. Ses enfants auraient dû sortir plus souvent et nouer davantage d’amitiés vivantes. Lui, mettait sa fille aînée sous embargo. Les longs cheveux de Louis l’horripilaient comme plus tard son engagement politique le hérissait. La « petite » ne réclamait rien, elle avait sa sœur et les bouquins de la bibliothèque municipale.
Quand la grande eut douze ans, le fils onze et la petite, sept, leur mère trouva un emploi à proximité de l’appartement. Sa vie faillit être plus agréable, elle rencontra de nombreuses personnes aux expériences et aux talents variés, parfois aux conversations agréables. Mais cette nouvelle vie l’épuisa. Tôt levée, elle préparera pendant des années les repas de midi pour ne plus livrer ses enfants aux cantines scolaires où ils mangeaient peu et mal. Louis voyant ses traits se faner éprouva une profonde tristesse et une forme de détresse. Voir vieillir ses proches devint une hantise. Sa propre vieillesse aggrava sa perception du temps qui passe, flétrit, abîme et tue.
¤¤
Édouard aimait sa fille aînée mais ne la comprit à peu près jamais au cours de son adolescence tourmentée, ne sut jamais l’encourager ni dans ses projets ni en lui montrant des voies. Il n’appréciait pas ses fréquentations, l’idée qu’elle sortît tard, qu’elle pût seulement flirter. Il voulait la garder, la protéger et tomba de l’armoire quand elle revendiqua à dix-huit ans, trois ans avant sa majorité, son émancipation légale sous chantage au suicide, ficha le camp, puis se mit à préparer la naissance d’un enfant.
Il s’occupa peu de la petite dernière, bavarde et solaire, qu’il aimait tendrement.
Il déplorait que son fils, les yeux au beurre noir, ne revînt pas victorieux de bagarres avec des voyous, ne le poussa pas à faire du sport, lui reprochait de porter les cheveux « à la manière d’une gonzesse ». Louis eut, en revanche, beaucoup plus d’argent de poche que ses sœurs parce qu’il alimentait clandestinement, contre promesse de remboursement – tenue, souvent hors délais –, les petits besoins récurrents de trésorerie dont le père avait besoin pour financer ses jeux de PMU et ses dépenses de bar. La mère tenant les comptes, Édouard n’était pas libre de disposer des fonds du ménage.
Louis fut le seul de la fratrie à recevoir chez eux ses copains et copines, soit pour des repas le midi ou le soir, soit pour des nuits s’agissant des secondes. Ce traitement inégal reposait sur des préjugés plutôt que sur des préférences.
¤¤
Louis et sa mère redoutaient les retards d’Édouard les soirs de semaine. Un accident, une escapade, un coup de foudre ravageur de familles, une fête arrosée, sachant que l’alcool qui l’adoucissait le rendait surtout stupide… Louis guettait aux fenêtres son arrivée lorsque l’heure habituelle de son retour était dépassée. Il ajoutait son inquiétude à celle de sa mère, satisfaite de ne pas être seule à se faire un sang d’encre. On faisait mieux dans l’accompagnement parental. Les sœurs restaient indifférentes, jouaient dans leur chambre et ignoraient la mauvaise ambiance. Au cours de leurs jeux, elles ne voyaient pas le temps passer ni le ciel s’obscurcir. Cette complicité, exclusive à certains moments, rendait Louis jaloux. Il aurait voulu échapper aux peurs de sa mère, à l’inquiétude pour son père, aux menaces d’éclatement qu’il pressentait de la si bien nommée cellule familiale.
¤¤
Édouard avait développé un complexe d’infériorité, il fuyait les conversations intellectuelles ou un peu cultivées. Il aimait la fréquentation de gens simples comme ceux qu’il côtoyait dans la pratique de la pétanque. Les concours qu’il remportait ou qu’il finissait aux places d’honneur avec ses coéquipiers lui procuraient beaucoup de plaisir. Là, il retrouvait des situations où sa maîtrise de la discipline boulistique en imposait et sa science de la bagarre faisait merveille quand il fallait calmer un abruti excité et violent ou deux imbéciles avinés. Il savait quand bien se tenir et y mettait un point d’honneur. Louis avait bien remarqué, au mitan de son adolescence, que son père n’aimait pas discuter avec lui de sujets devant mobiliser des connaissances générales, voire scolaires, qu’il craignait de ne pas avoir. Il mettait ce constat en relation avec cet autre quand son père voulait se mesurer à lui dans de petites joutes sportives. Il se souvient d’un pari fait sur une plage méditerranéenne. Une course de vitesse d’environ quatre-vingts mètres au bord de l’eau sur le sable ferme. Le père, sans entraînement, fumeur en surpoids, ne pouvait pas le battre. Le fils, à quatorze ans, le laissa gagner, l’homme ne se douta de rien et fut heureux d’avoir remporté ce défi ridicule. Grand seigneur, payé par sa victoire, il fit grâce du montant de la somme en jeu.
Louis perdait toutes ses parties de ping-pong et de pétanque contre lui jusqu’à ce qu’il… cesse de jouer. Il détestait se confronter à son père, vorace de victoires. Face à son fils, il importait qu’Édouard fût le plus fort. En sport comme en jeux.
¤¤
Il quitta l’armée vers quarante ans pour occuper dans une institution privée des fonctions d’encadrement d’un personnel de service nombreux. Il exerça dans un quartier prestigieux de la capitale régionale et s’adapta parfaitement. Il fréquenta des gens éduqués, cultivés et intelligents. Cette nouvelle étape contribua à lui ouvrir l’esprit plus que l’armée le fit.
Une dizaine d’années plus tard, il suivit Noëlle nommée dans le Var au poste convoité dès sa première candidature. Édouard abandonnant son bel emploi la suivit, ils délaissèrent la petite dernière qui n’avait pas dix-huit ans et dont les projets n’étaient pas encore bien affermis. Elle déprima mais tint le coup. Son frère, Louis, ne fit rien pour qu’elle aille mieux, il préparait égoïstement – comme tout ce qu’il avait toujours fait – son départ pour le service militaire dont il attendait qu’il fût favorable à une réflexion sur son avenir qui s’annonçait mal. Dans un régiment domicilié à proximité de chez ses parents.
Dans le jardin attenant à leur petite maison de Provence qu’ils avaient achetée une dizaine d’années avant la mutation de Noëlle, Édouard avait construit un vaste four à bois pour la cuisson de son pain, de gâteaux et de toute préparation qu’une cuisson longue sous la brique réfractaire transcendait. Il avait repris ses gestes de boulanger et acheté les outils qui convenaient : toile de lin, filet, plaque et grille de cuisson, bannetons, pelle en bois. Il avait renoué avec la confection des croissants qu’il avait abandonnée une dizaine d’années plus tôt. Pour leur préparation et pour en disposer le matin, au petit-déjeuner des enfants, il se levait au moins trois fois pendant la nuit. Ils étaient délicieux. Édouard se vexait, se fâchait, quand sa fille aînée, coupant le croissant en deux dans la longueur, y ajoutait du beurre dont il était déjà fait et de la confiture. Pour avoir essayé, son frère confirmait que c’était un régal.
Adulte accompli, Louis adorait voir son père préparer pour la soirée la partie de pizzas personnalisées et allait avec lui et sa mère chercher les vins rouges et rosés qui conviendraient, avec l’espoir que le soir venu, le père n’en abuserait pas. Ce qu’il était capable de faire.
¤¤
Parce que leurs enfants ne venaient plus les voir aussi souvent que par le passé, parce que leurs frères et sœurs vieillissants ne s’y invitaient plus non plus, parce qu’ils étaient loin de tous, avaient peu d’amis, ils finirent par s’ennuyer.
Ils perdirent la vie après que leur voiture eut versé dans un ravin bordant la nationale 7 en roulant à… 30 km/h (dixit les gendarmes qui fortuitement les suivaient et furent témoins de l’inhabituelle trajectoire d’une voiture dans un virage).
¤¤
Louis avait évoqué le racisme d’Édouard et insisté sur le fait qu’il s’en était débarrassé. Il s’était dissous sous l’influence de ses enfants ; quelques détestables autres préjugés suivirent. Il améliora sa vision du monde, se convertit en vieillissant à plus d’écoute et de confiance en lui et les autres, se laissa aller à de meilleures influences. Son penchant pour l’alcool restait tenace mais reculait. Apparemment, Louis qui éclusait des verres en révélant de plus en plus l’intimité de la famille avait le même.
Édouard était heureux quand la famille recevait et qu’il pouvait cuisiner, manger, boire et rire. Finalement, cet homme était un bon vivant partageur et altruiste, ce qu’il avait manifesté en venant au secours de gens qu’il ne connaissait pas, tel ce travailleur africain, croisé tous les jours dans un autobus, à qui il conseilla, en prenant le temps de la pédagogie, de consulter d’urgence un médecin parce que sa toux souvent entendue qui semblait ne pas devoir cesser était infiniment suspecte. Ce n’est que trois ans plus tard, après être à nouveau tombé sur l’homme qui avait disparu de la ligne de bus, et avait guéri de la tuberculose, qu’il put s’enorgueillir de l’avoir incité à se soigner à temps. Cet homme guettait le moment où il rencontrerait à nouveau son bienfaiteur – ce qui advint peu de temps après son retour –, pour lui donner rendez-vous le lendemain et lui faire alors cadeau d’un joli sabre africain dans son fourreau de cuir tressé, en témoignage de sa reconnaissance. Rapportant ce haut fait d’armes, le Père avait les larmes aux yeux.
FIN
Avis aux lecteurs
Un texte vous a plu, il a suscité chez vous de la joie, de l'empathie, de l'intérêt, de la curiosité et vous désirez le dire à l'auteur.e ?
Entamez un dialogue : écrivez-lui à notre adresse nouveaudecameron@albiana.fr, nous lui transmettrons votre message !